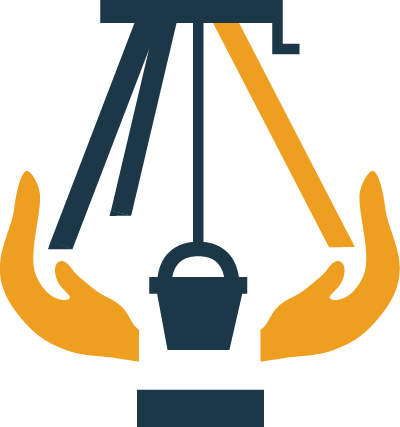Un an après la publication des travaux de la Ciase, la psychanalyste Marie Balmary, membre de la Commission indépendante pour les victimes d’abus sexuels commis par des religieux et religieuses, explique la difficulté pour une victime de prendre la parole pour « dire le mal », encore plus lorsqu’elle a subi des abus spirituels.
• Marie Balmary, psychanalyste
• le 07/10/2022 à 16:30
Lecture en 5 min.
Lien de l’article sur le site de LA CROIX : Abus spirituels : « Se servir de la confiance en Dieu de la victime pour l’asservir est particulièrement affreux »
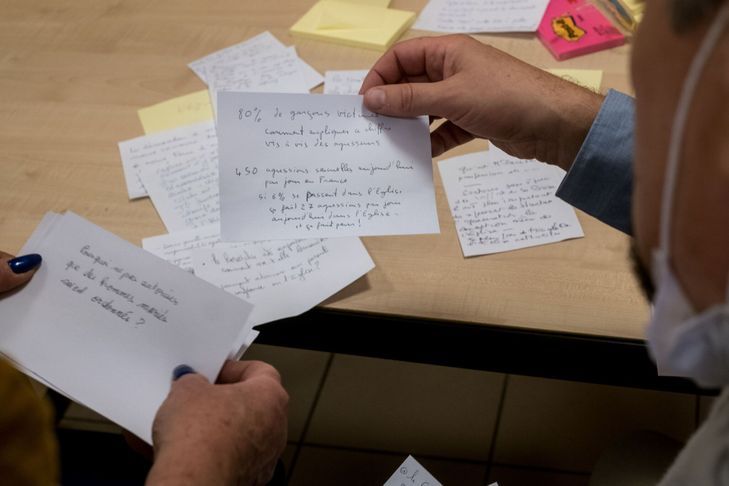
Dépouillement des questions posées par les fidèles après la remise du rapport Sauvé, à la maison diocésaine de Bondy, le 22 octobre 2021
La première phase du soin est évidemment l’accueil et l’écoute de la victime. Écouter… Il se trouve que, au plus profond d’elle-même, une victime sent si elle est ou n’est pas vraiment écoutée. L’écoute est une attitude qui ne trompe pas. Ou plutôt, ce n’est pas une simple attitude, c’est un état d’esprit, un état d’accueil. De cette qualité d’accueil dépendent la liberté de parole de la victime et le niveau de mémoire qu’elle pourra atteindre et communiquer à celui ou celle qui l’écoute.
À lire aussi Abus sexuels dans l’Église : il y a un an, la déflagration du rapport Sauvé
Notre écoute n’est pas l’étape de la prise de conscience d’un traumatisme refoulé. Ça, c’est la psychothérapie. Notre travail, à la commission, est d’abord de rendre possible un récit par la victime de ce qu’elle a déjà conscience d’avoir vécu, mais dont elle n’a pas pu parler pour faire reconnaître ce récit par les responsables de l’institut dont son agresseur faisait partie – et par sa propre communauté si elle en fait encore partie.
Notre plus grande attention
Le récit du mal subi requiert notre plus grande attention. Il est nécessaire qu’il soit composé un jour avec les mots précis qui rendront compte de la violence subie. Des mots souvent très déplaisants. Pourtant il faut parvenir à « appeler un chat un chat », selon une expression qui revient souvent. Or, les mots précis d’un abus sexuel sont des mots crus, des mots du corps, dont on ne parle pas entre gens bien élevés.
À lire aussi Abus sexuels dans l’Église : des jeunes catholiques partagés face au rapport Sauvé
Il n’est pas facile pour une victime, jeune ou pas jeune, de raconter ce que lui a fait subir son agresseur. Le mot ne se trouvait pas dans son vocabulaire – et cette absence de mot pour le dire fait partie du trauma : les mots pour raconter manquent à la victime lors des faits. Ce qui a été vécu ne pouvait donc pas être parlé par elle à d’autres ni même à l’intérieur d’elle-même. Les mots exacts, si elle les connaît, peuvent faire honte à la victime, lui donner l’impression qu’ils lui saliraient la bouche si elle les prononçait.
Croire les victimes
Prendre soin, c’est offrir à la victime cette écoute active, l’écoute qui permet à la fois d’oser les mots pour le dire, de supporter de les dire, de supporter d’être écoutée par d’autres en les disant. Sans jugement. Quelque chose que presque toute victime nous raconte, c’est qu’elle a déjà essayé de parler. Bien souvent, elle a parlé à quelqu’un de proche, un supérieur, un prêtre. Mais dès qu’elle a eu raconté au moins un peu ce qui lui est arrivé, elle a senti qu’elle n’était pas crue.
C’est aussi une phase de notre écoute que ce récit par la victime des moments, des personnes par lesquelles elle n’a pas été écoutée. Et pour elle, parler à quelqu’un qui ne l’écoute pas, c’est pire que ne pas être écoutée du tout. Et cela, toutes le disent, c’est parfois pire que l’agression elle-même. D’autant que, si on ne la croit pas – et j’ajoute avec le verbe « croire » une autre dimension du soin –, sa dénonciation du mal va se retourner en accusation contre elle – comment ose-t-elle mettre en cause telle personne, souvent réputée admirable, voir sainte ?
Une indignation
Dans le soin de la victime entre donc le fait de la croire. C’est la deuxième réparation essentielle : après être écoutée, c’est être crue. D’autant plus important que, bien souvent, la victime, même si elle voit bien les effets dévastateurs dans sa vie de ce qu’elle a subi, peut aussi douter de ce qu’elle a vécu (spécialement lorsqu’elle était enfant lors de l’abus.)
À lire aussi Abus sexuels sur mineurs, le continent oublié
Avec le fait d’être crue va venir un autre soin : celui qui l’écoute partage avec elle une indignation. Alors que, jusqu’à maintenant, il est arrivé qu’on lui dise : « Ce n’est pas si grave » ou bien « Tu pourrais voir les choses autrement ». Notre indignation ne dit rien d’autre que cela : ce que lui a fait son agresseur lui a fait mal parce que c’est mal. Point. Et je crois très important que l’écoutant soit certain en lui-même que les gestes, les paroles de l’agresseur sont mal.
Alors s’enclenche une autre étape du soin. La victime, assurée maintenant qu’elle a bien subi quelque chose de grave de la part de son agresseur, cette fois se demande : mais pourquoi n’ai-je pas refusé, ne me suis-je pas enfuie, n’ai-je pas même protesté ? Que pouvons-nous répondre à cet effondrement de l’estime d’elle-même ?
Abus spirituels particulièrement affreux
Je crois qu’il nous est nécessaire d’avoir une connaissance des effets de la perversion. L’agresseur a fait quelque chose qui le sort de sa place, il n’est plus un homme en face d’un autre humain, il est… – elle ne sait pas ce qu’il est mais elle, elle n’est plus rien, elle est une chose. La victime est sidérée au sens propre (sidéré, cela veut dire : que quelqu’un est frappé d’un anéantissement subit des forces vitales).
Il est utile alors d’avoir connaissance d’autres cas, de savoir ce qu’est la sidération devant la perversion d’une personne ayant autorité. Il est utile de témoigner devant la victime que la résistance n’est pas possible dans cette situation, que l’enfant ou la personne vulnérable « perd ses moyens », comme on dit. Voire « abandonne son corps » à l’agresseur, comme les enfants peuvent le raconter.
À lire aussi Des religieux regardent en face le risque d’abus spirituel
Prendre soin des personnes victimes dans l’univers des religieux et religieuses, c’est aussi, à mon sens, peu à peu adapter son écoute à ce que les abus spirituels qui sont à l’origine de ces crimes ont de particulièrement affreux. Il ne s’agit pas d’un abus de force physique, ni même seulement d’un abus de position dominante, mais de se servir de la confiance en Dieu de la victime pour l’asservir à soi.
Auprès de qui trouver du secours
Cela peut être rapproché d’un inceste mais en même temps cela en diffère sur un point essentiel. Pour l’enfant victime d’inceste par le père, par exemple, il ne s’agit que de son père à lui. Pas de tous les pères. Mais dans l’abus spirituel, dans nos cultures monothéistes, il s’agit de la relation à Dieu, c’est-à-dire que, pour les croyants, il s’agit du Père, l’Autorité suprême, il n’y en a pas d’autre. Si le prédateur (la prédatrice) fait croire à la victime qu’il (elle) détient la parole de Dieu à son égard, qu’il connaît la volonté de Dieu, le projet de l’Esprit Saint sur elle, vers qui aller pour trouver du secours ?
À lire aussi Qu’est-ce qu’un abus d’autorité ?
Prendre soin de la victime, c’est, enfin, ne pas la voir uniquement comme victime, élargir l’écoute. Elle n’est pas une victime, quand elle vient nous voir, comme cela a été mis en lumière par la Ciase, sa démarche même vers nous fait apparaître son changement de place : Elle ne subit plus le mal, elle le raconte. Elle est passée de victime à témoin. À elle maintenant l’initiative en face du mal.